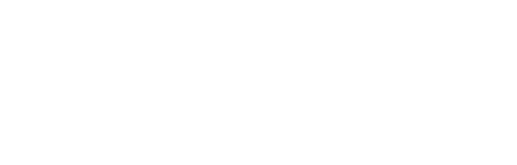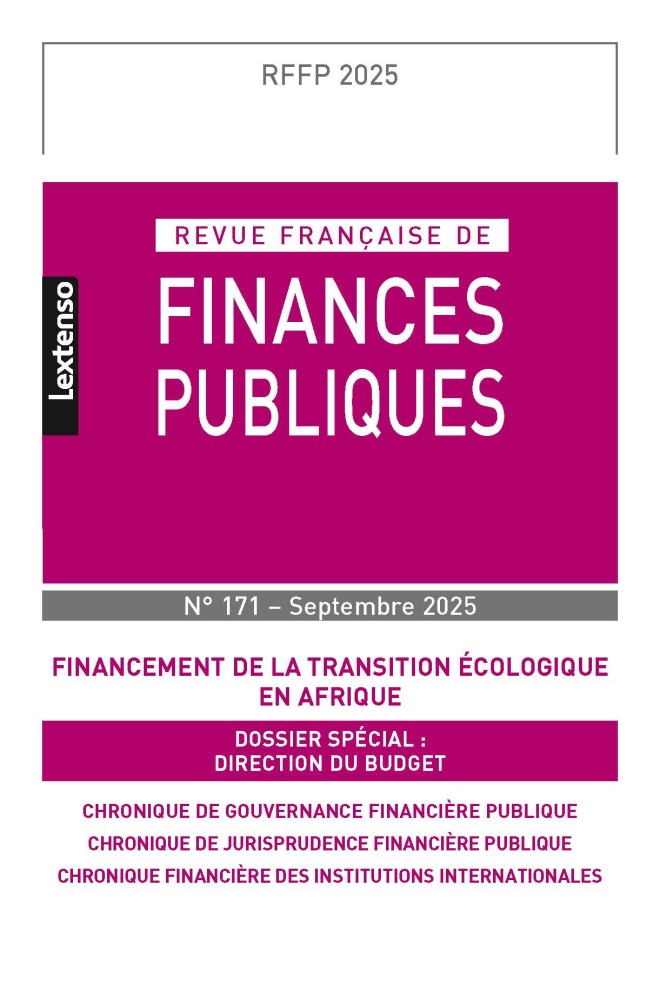Éditorial
L’État-stratège peut-il encore avoir un sens ?
L’État et la gouvernance financière publique s’inscrivent aujourd’hui dans un monde en transition ponctué de crises successives depuis plus d’une quarantaine d’années (crises économiques, sociales, sanitaires, géopolitiques). Plus encore, l’IA, la mondialisation des échanges perturbée par la politique douanière américaine ainsi qu’un ordre international en proie à des conflits armés et en pleine reconstruction, bouleversent le fonctionnement des sociétés et accentuent le déséquilibre général de systèmes financiers publics qui ne disposent pas d’un modèle adapté à leur nouvel environnement. C’est par conséquent, dans un tel contexte, un enjeu redoutable pour l’État que de parvenir à déterminer et développer une stratégie en général et une stratégie des finances publiques en particulier qui en sont l’ossature, il faut le souligner. Il en résulte que les réponses apportées aux multiples et graves problèmes qui se posent le sont au coup par coup, dans l’urgence, le plus souvent sur la base de références théoriques ou de pratiques qui, si elles avaient pu faire leurs preuves au XXe siècle se révèlent le plus souvent inefficaces dans le contexte contemporain. Or, les mutations du monde actuel devraient conduire à prendre de la distance avec ce qui semblait jusqu’alors aller de soi. Il est tout aussi illusoire d’estimer que l’utilisation d’instruments de contrôle de la gestion très sophistiqués – qui relève de la tactique – puisse tenir lieu de stratégie car ce qui est en cause est beaucoup plus fondamental, il est en effet question, au-delà du pilotage de la gestion, certes nécessaire, de la pertinence du modèle de gouvernance et donc de la régulation du système financier public.
Nous sommes en effet en présence de l’évolution d’un monde multipolaire, dont la complexité est inédite ; un monde en équilibre très instable, sans plan, plus encore sans stratégie ; un monde dont il est impossible de percevoir le sens et de maîtriser les développements. Le champ des finances publiques est particulièrement sensible à ce contexte car y interagissent de multiples acteurs nationaux et internationaux, publics et privés aux intérêts et modes de fonctionnement très divers. Au sein d’un ensemble aussi mobile, disparate et volatil, les stratégies volontaristes dans lesquelles un État peut s’engager sont, à un moment ou à un autre, vouées à être remises en question ce qui peut être totalement décourageant et amener à conclure que c’est peine perdue de poursuivre en ce sens.
Cette conclusion est soutenue avec vigueur par nombre de penseurs ultra-libéraux pour qui, à la suite de F. Hayek, les sociétés ne s’organisent pas par le haut, selon la volonté des gouvernants, mais par elles-mêmes, de l’intérieur selon une auto-organisation qui s’opère par une lente maturation d’un ordre social spontané. Il est donc inutile dans ce cas de prétendre diriger volontairement la société car son mode de fonctionnement est impossible à connaître tant les rapports sont complexes, multiples, en constant changement. C’est le marché qui est essentiel et le marché n’a pas de stratégie réfléchie. Il est cependant essentiel parce qu’il constitue un système en perpétuel changement qui, s’il n’est pas contrarié par l’intervention volontariste de l’État, laisse s’exprimer des diversités individuelles et, partant, constitue une source d’information inégalable sur l’état de la société et surtout un champ où se confrontent, inter-réagissent ces informations. Autrement dit, le marché laisse émerger un savoir de la société sur elle-même qui est consciemment ou non utilisé par les individus dans leurs choix. Mais ce n’est pas pour autant que l’on peut connaître avec certitude la réalité d’un contexte en perpétuel mouvement, en constante reconstruction. L’incertitude est donc posée en principe et ceci à l’encontre d’un «rationalisme constructiviste», c’est-à-dire «une conception qui tient pour certain que toutes les institutions sociales sont le produit d’un dessein délibéré et doivent l’être ». Finalement, « l’inéluctable ignorance de la plupart des données qui entrent dans l’ordre de la grande société est la racine du problème central de tout ordre social... des millions d’hommes réagissent les uns sur les autres... Chacun ignore la plupart des faits sur lesquels repose le fonctionnement de la société ». Par conséquent on ne peut qu’en déduire que « l’homme n’est pas le maître de son destin et ne le sera jamais ».
Dans ces conditions la notion de stratégie n’a plus aucun sens et le concept d’État-stratège, opposé à celui d’État-administratif , tel qu’il a été pensé il y a quarante ans, perd toute crédibilité. Néanmoins, on peut, à contrario, estimer qu’il est hasardeux d’accorder une confiance absolue à une autorégulation du marché à un moment où il s’avère crucial de maîtriser un déficit et une dette publique susceptibles de mettre en cause l’équilibre général de la société. Mieux, si l’on en croit les « maîtres de la stratégie » militaire, celle-ci se caractériserait justement par le fait qu’il s’agit d’« un processus d’adaptation permanent », une affirmation qui s’applique d’autant plus aux sociétés contemporaines qui sont des ensembles hyper complexes au sein desquels les processus de décisions ne sont pas linéaires mais multirationnels et le plus souvent aléatoires.
Il est aussi avéré que la crise permanente ou quasi permanente en vient aujourd’hui à être considérée comme faisant partie du mode de fonctionnement normal des États ; ce qui au fond constitue une acceptation sans précédent d’un principe d’incertitude qui veut que « ce ne sont plus d’abord les situations stables et les permanences qui nous intéressent, mais les évolutions, les crises et les instabilités ». C’est là une raison suffisante non pas pour demeurer inactif mais pour considérer que le pilotage nécessite une grande souplesse car il s’inscrit dans un processus dynamique pouvant conduire à modifier à chaque instant les plans et les dispositifs initialement prévus ou mis en place. Mais il ne s’agit pas pour autant de revenir à l’État interventionniste, centralisé, et quasiment caricatural, que la France a autrefois connu, il ne s’agit pas non plus de laisser se développer à l’infini des pouvoirs autonomes horizontaux, économiques ou politiques, au risque de voir s’installer des néo féodalités.
En dépit d’un contexte qui plaiderait pour l’inaction, une stratégie des finances publiques est parfaitement concevable à condition qu’elle tienne compte de la dynamique constante des acteurs, donc de l’incertitude qui lui est inhérente. C’est pourquoi il ne serait pas pertinent de construire abstraitement un modèle de stratégie puis de le mettre mécaniquement en application pas plus que de maintenir en vigueur des règles ayant pour effet de paralyser l’action publique. De tels scénarios ne pourraient que se traduire par une rigidité dans l’action en particulier s’ils s’appuyaient sur d’anciens ne correspondant plus à la réalité du moment. Le risque d’erreur est d’autant plus grand que les sociétés contemporaines fourmillent d’acteurs publics et privés qui interagissent sur fond d’un environnement dangereux et imprévisible. Ignorer l’extrême mobilité d’un milieu et donc négliger la nécessité à un moment ou à un autre de modifier les objectifs et les actions ne peut que conduire à l’échec.
En réponse, il est nécessaire d’instituer un modèle de gouvernance financière publique permettant de réagir en temps réel et de manière ad hoc aux problèmes que rencontrent les finances publiques. Il s’agit de bâtir un dispositif de gestion et de décision suffisamment souple pour être en mesure de s’adapter spontanément aux changements de contextes, autrement dit, un modèle de gouvernance financière publique parfaitement ancré dans la réalité à laquelle il s’applique et donc susceptible de s’accorder en permanence avec les évolutions de cette réalité. La création d’un tel modèle suppose une méthodologie ouvrant sur la mise en place d’institutions ne séparant pas les éléments, acteurs et structures, agissant au sein du système financier public mais les intégrant dans un ensemble dynamique.
En effet, c’est encore aujourd’hui une approche « en silos » qui domine associée à une distribution des pouvoirs politiques qui ne reflète pas la complexité du pouvoir financier. Or, il convient de ne pas perdre de vue que l’espace public est devenu un espace à géométrie variable qui fourmille de micro décisions prises par des acteurs, dont la diversité ne fait que s’accentuer d’années en années, ayant des objectifs qui ne se situent pas toujours à la même échelle spatiale (locale, nationale, internationale) ou qui sont plus ou moins déterminés par des pesanteurs différentes (historiques, sociologiques, culturelles).
Par conséquent c’est un modèle devenu inadapté qui est en cause et celui-ci ne peut prendre une forme nouvelle qu’en s’inscrivant dans un processus de mise en cohérence de ses différentes composantes. Le pilotage des finances publiques ne peut pas se limiter au budget de l’État pas plus qu’à celui des finances sociales ou des finances locales. Les finances publiques sont composées de ces trois catégories et il est indispensable de mettre en place un lieu de partage des informations qu’elles détiennent et de coordination des actions qu’elles mènent.
Aucun texte juridique ni aucun dispositif gestionnaire ou institutionnel construit ne répondent directement à ce besoin. Toutefois, les prémices sont déjà présentes. Une sorte de cohérence encore « aventureuse » est déjà là ; elle a pris naissance il y a quelques décennies. Elle a été clairement posée avec la montée en puissance de la décentralisation financière. Il faut rappeler qu’un rapport datant de 1976, le rapport Vivre ensemble, relevait déjà que les finances publiques devaient s’entendre de l’association des finances de l’État, des collectivités locales et de la sécurité sociale. La réflexion s’est poursuivie ensuite avec le développement de la communauté européenne jusqu’à prendre une forme juridique avec le traité de Maastricht (1992) qui impose une approche globale des finances publiques. Selon la même approche et depuis la révision de 2008, la Constitution, dans son article 34, évoque « les orientations pluriannuelles des finances publiques... définies par des lois de programmation (qui) s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques ». Dans le même sens le Conseil de l’Union européenne a adopté une directive le 8 novembre 2011 déterminant les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres. Selon ce texte les États membres ont été tenus de mettre en place « des mécanismes appropriés de coordination entre les sous-secteurs des administrations publiques afin d’assurer l’intégration complète et cohérente de tous ces sous-secteurs des administrations publiques dans la programmation budgétaire, dans l’élaboration des règles budgétaires chiffrées spécifiques au pays, ainsi que dans l’établissement des prévisions budgétaires ».
On l’a compris, une démarche inclusive se dessine qui rend la stratégie inhérente au modèle de gouvernance financière publique. Ce n’est pas la production d’un modèle de stratégie ou d’un plan susceptible d’être déroulé en fonction d’objectifs préalablement posés qui importe mais un modèle « finances publiques » susceptible d’évoluer avec son milieu parce qu’en mesure de s’y adapter, d’une part en disposant d’un maximum d’informations du fait de la pluralité d’acteurs et de structures qui le composent et s’y expriment, d’autre part, en développant des propositions résultant de discussions ayant fait apparaître la disparité des opinions ainsi que les points de convergence possibles.
Ces textes expriment une rupture avec une conception cloisonnée de l’État et de l’action publique qui ne reconnaît pas, et a fortiori ne les formalise pas, les multiples interactions et la multirationalité qui caractérisent les sociétés contemporaines. Il n’est plus pertinent en effet de concevoir de manière isolée les diverses institutions publiques ou privées qui forment une société. Il est même devenu crucial d’identifier le décalage qui peut exister entre les besoins actuels et des institutions administratives et politiques qui ont été conçues et déterminées, en leur temps, par la nécessité de séparer les acteurs et les structures ainsi que par une approche verticaliste du processus de décision. Une telle façon de penser et d’agir n’est plus d’actualité. Il est nécessaire de construire un modèle financier public fondé sur une gouvernance plurielle et partenariale des acteurs concernés.
La voie est donc étroite car elle ne peut que se formaliser dans un modèle transversal associant unité et diversité. Il s’agit de bâtir un ordre des autonomies relatives organisé à la fois sur un plan vertical et horizontal, autrement dit transversal, et de rompre ainsi avec des pesanteurs de toutes sortes.
On l’a dit, un impératif majeur est de disposer d’un modèle de gouvernance financière publique apte à fournir toutes les informations nécessaires pour répondre efficacement aux fluctuations du milieu dans lequel il évolue. Or, ces informations ne peuvent se limiter à des calculs abstraits fondés sur des modèles mathématiques ; il est nécessaire de disposer d’une connaissance du milieu permettant de déterminer avec le maximum de précision les leviers sur lesquels il est possible d’agir pour contrôler/piloter les finances publiques. Il n’est pas ici question d’un modèle de stratégie, celle-ci est le produit naturel du dispositif. Il s’agit là d’un volontarisme mesuré qui consiste non pas à forcer le destin mais à mettre en place un nouveau modèle de gouvernance financière publique conduisant à ce que soient réduits au strict minimum, voire à zéro, les obstacles à la réalisation du résultat recherché.
De ce point de vue, le lancement le 11 janvier 2006 par le Premier ministre de la première «Conférence nationale des finances publiques» (CNFP), a constitué un palier important que nous appelions de nos vœux depuis longtemps. Cette conférence réunissant les représentants des trois grandes composantes des finances publiques, État, collectivités locales, sécurité sociale, avec pour objectif de dégager les voies d’une maîtrise des dépenses publiques et de la dette était significative de l’entrée – certes encore très timide – dans une nouvelle culture de la décision financière publique. Même si elle n’a pas été identifiée comme telle, la CNFP – qui devait se réunir chaque année, mais ce ne fut hélas pas le cas, a finalement été supprimée. Elle figurait cependant l’embryon d’une future institution de régulation des finances publiques indispensable dans un système financier qui se caractérise par sa diversité et par conséquent par sa complexité. Les États généraux des comptes qui se sont tenus le 6 juillet 2017 à Bercy à l’initiative du ministre de l’Action et des Comptes publics et auxquels étaient conviés les parlementaires, les représentants des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale, les partenaires sociaux, des personnalités de la société civile ainsi que le premier président de la Cour des comptes, s’inscrivaient très timidement dans cette logique mais ce fut sans lendemain. La conférence nationale des finances publiques, organisée le 15 avril 2025, réunissant l’État et ses partenaires ne fut pas non plus une réelle réussite. Quoi qu’il en soit, il conviendrait de réévaluer la pertinence et la portée de ces expériences ainsi que de réfléchir à la forme qu’elles pourraient prendre aujourd’hui.
En effet, ces réunions peuvent se lire comme un signal fort, celui d’un sursaut collectif associant tant la classe politique nationale et locale que les responsables sociaux face à la gravité de la situation budgétaire et financière et au pronostic sombre de « faillite attendue » d’une France qui s’est habituée à vivre largement au-delà de ses moyens et qui voit le volume de sa dette s’amplifier d’année en année. Toutefois pour que ne se répètent pas les échecs des « conférences » précédentes, il est primordial que ce décloisonnement des acteurs financiers publics prenne forme institutionnelle autrement dit pérenne et permanente. Il est aussi essentiel qu’une telle institution ne se limite pas à la maîtrise de la dépense mais qu’elle ait à réfléchir également à celle tout aussi importante des ressources et notamment de la fiscalité. Par ailleurs, elle devrait être dotée de moyens lui permettant de disposer d’experts représentant les diverses facettes des finances publiques : économie, droit, gestion ainsi que d’un statut juridique définissant ses attributions. Une telle direction, si elle était prise serait propice à une régulation des finances publiques dans le cadre d’un État-stratège, un État qui devrait être fondé sur la confiance entre les acteurs financiers publics.
Michel BOUVIER