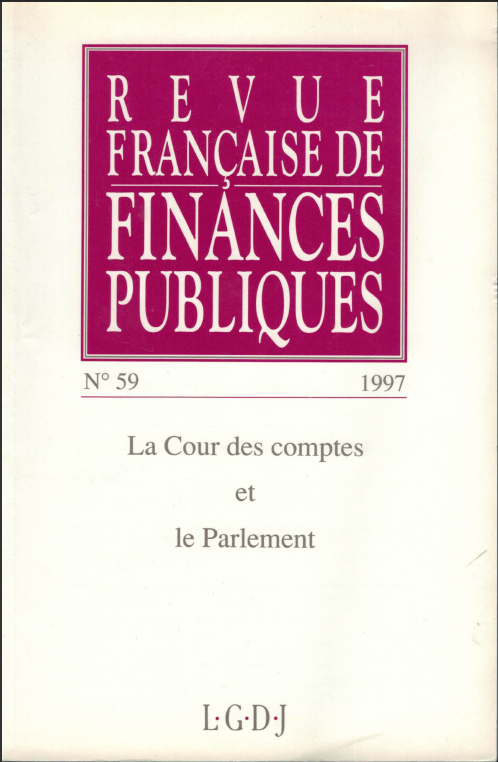ÉDITORIAL
Il y a assurément une donnée constante de l'histoire financière ; c'est dans les moments où l'argent public se fait plus rare que le besoin d'en contrôler l'usage apparaît plus que jamais indispensable voire même vital pour la pérennisation de l'organisation collective. Et c'est au cours de ces mêmes périodes que tout naturellement les regards se tournent vers les institutions paraissant comme étant les plus expertes ou les plus capables de répondre à l'attente de davantage de transparence et d'efficacité dans l'utilisation des fonds publics, et à tout le moins à une réduction des gaspillages.
Parmi les institutions de contrôle les plus directement concernées par un tel objectif, la Cour des comptes tient une place privilégiée. Ses fonctions juridictionnelles, les procédures originales qui sont les siennes, sa spécialisation en matière financière, ses traditions, son indépendance, la compétence qui lui est reconnue sans réserve, non seulement lui confèrent une place singulière parmi les institutions financières mais suscitent également de la part du public un sentiment de respect sans équivoque.
L'on peut constater au demeurant que les différents pouvoirs et centres de décision actifs au sein de la société française semblent avoir porté une attention accrue, au fil de ces dernières années, aux travaux de la Cour. Par voie de conséquence, les liens de celle-ci avec les pouvoirs publics et notamment avec le Parlement, sont devenus plus étroits et la place de la Cour dans le processus de décision budgétaire, et partant politique, semble ainsi connaître une évolution sensible en allant dans le sens d'un renforcement de sa position d'expert.
Sans préjuger des aspects particuliers qu'une telle évolution suscite - notamment quant aux moyens du juge des comptes pour y faire face - on peut se demander s'il n'y a pas là sur le fond l'esquisse d'une restructuration en profondeur du système de décision politique en matière financière, laquelle inclut notamment une redéfinition des relations existant entre les représentants des citoyens et le juge des comptes. Car à la faveur des rapports plus étroits que l'on constate en effet entre Parlement et Cour des comptes, c'est aussi l'émergence d'une nouvelle logique du pouvoir que l'on peut déceler, mue par le besoin d'intégrer plus fortement technique et politique. La conviction demeure certes que le sens à donner à la société appartient en propre au pouvoir politique. Mais il semble désormais admis que ce dernier ne peut plus faire l'économie d'une aide à la décision, c'est-à-dire du point de vue technique de l'expert.
Sans doute le Parlement constitue-t-il lui-même un lieu particulièrement propice à l'établissement de tels liens tant il évolue aujourd'hui dans un environnement économique et social qui se caractérise par une particulière technicisation de ses problèmes. Cependant, on sait aussi que le rôle normatif de l'expert ne peut être négligé dans un tel contexte et que le risque d'une évolution vers un pouvoir des experts, voire même vers une république des experts comme elle a pu être pensée en d'autres temps, nécessite l'édification de dispositifs juridiques définissant clairement les rapports entre des instances de décision et celles ayant un rôle d'expertise.
Quoiqu'il en soit, ce besoin croissant de transparence et de démocratie dans les finances publiques, associé à cette nécessité accrue de l'expertise qui se développe comme une logique générale lourde au sein des sociétés complexes, pourrait bien peser d'un poids toujours plus important sur les rapports de la Cour avec les pouvoirs publics - et tout particulièrement avec le Parlement - d'une part en raison de la position incontestée d'expert indépendant de l'une, d'autre part du fait de la place fondamentale de l'autre dans le système démocratique.
Michel Bouvier