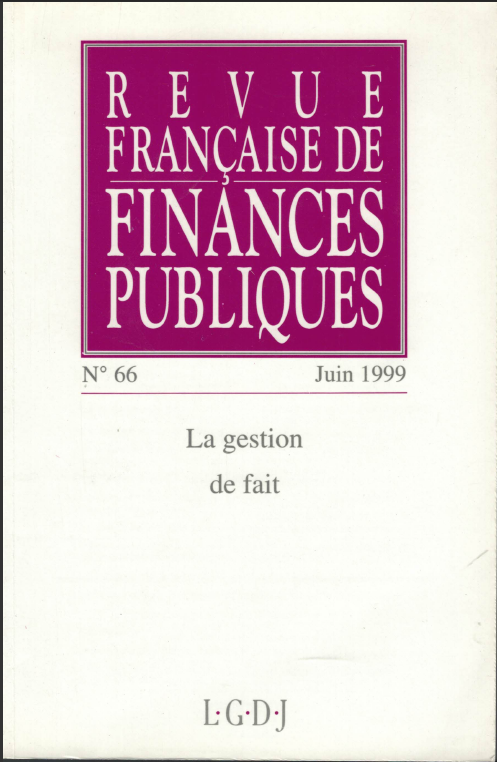ÉDITORIAL
La gestion de fait est aujourd'hui au cœur du malaise que ressentent les élus locaux lorsqu'ils sont placés en situation de devoir faire des choix, d'agir avec efficacité et rapidité. En effet, l'autonomie introduite par les lois de décentralisation, l'esprit d'entreprise qui, dans la foulée, a plus ou moins marque les politiques et les pratiques locales, la compétition qui s'est parfois développée entre collectivité territoriales ou plus encore, l'accumulation des problèmes à résoudre et des contraintes à surmonter, constituent autant de facteurs susceptibles de faire oublier aux décideurs locaux que leurs opérations sont soumises à contrôle et qu'il existe à cet égard une règle d'or en droit de la comptabilité publique : la règle de la séparation de l'ordonnateur et du comptable.
Tantôt portée aux nues comme le fleuron d'un contrôle efficace des finances publiques, tantôt vigoureusement critiquée comme la parfaite illustration de la lenteur et de la complication bureaucratiques, la règle, depuis de nombreuses années, a fait l'objet de discussions d'ordre plutôt doctrinal ou théorique. On peut toutefois observer que les débats traditionnels à son sujet ont largement été délaissés et que s'y sont substituées les inquiétudes fortes exprimées par les élus locaux quant aux risques réels ou supposés qu'ils encourent d'être déclarés comptables de fait.
Ainsi, du terrain de l'organisation administrative et de la gestion publique, la question s'est avant tout déplacée aujourd'hui sur le terrain juridictionnel alors que sur le fond, il s'agit bien toujours du même problème qui se trouve en cause, celui du bien fondé de la séparation ordonnateur/comptable, autrement dit du contrôle des deniers publics ou mieux encore du contrôle de l'utilisation de l'argent public.
En effet, la question primordiale que pose la gestion de fait est de savoir évaluer la pertinence du dispositif de contrôle de base qui est le nôtre, confronté désormais à deux catégories d'impératifs qui relèvent de deux logiques qu'il convient d'intégrer : une logique gestionnaire, supposant notamment rapidité d'action, souplesse, responsabilisation des acteurs…, et une logique politique déterminée quant à elle par la raison démocratique.
Évaluer un dispositif suppose, on le sait, d'en comprendre parfaitement les mécanismes, de mettre en évidence ses dysfonctionnement et de tracer quelques directions pour l'avenir eu égard aux réalités du moment. C'est bien ce à quoi se sont attachés avec brio les auteurs de cette nouvelle livraison de la RFFP grâce auxquels tous ceux qui sont intéressés par le sujet, chercheurs, élus, praticiens, trouveront ici ample matière à réflexion.
Michel Bouvier