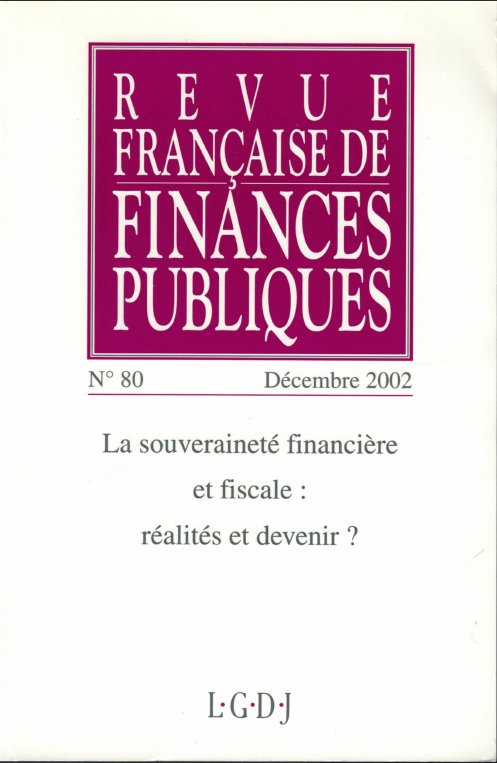
Hommage à Jean-Pierre Lassale , par Michel Bouvier , Marie-Christine
Esclassan, Robert Hertzog, Gabriel Montagnier et Luc
Saïdj
• LA SOUVERAINETÉ FINANCIÈRE ET FISCALE :
RÉALITÉS ET DEVENIR?
Avant-propos, par Jean-François Bernicot
Les politiques budgétaires en UEM : une autonomie surveillée,
par Hervé Carré
La procédure budgétaire européenne : réformes et
enjeux, par Catherine Guy-Quint
L’impact de l’élargissement sur les finances européennes,
par Anne Bosche-Lenoir
Un financement plus démocratique du budget européen : un défi
pour la Convention européenne, par Sylvie Goulard et Mario Nava
Souveraineté fiscale et Union européenne, par Bernard Castagnède
L’émergence d’un référentiel financier et comptable
international pour le secteur public, par Philippe Adhémar
Transparence budgétaire : où en est-on?, par Benoît Chevauchez
La question de l’autonomie fiscale, par André Barilari
Réflexions sur le fédéralisme financier : modèle
ou méthode pour les systèmes composés?, par Robert Hertzog
Autonomies financières et fiscales. Brèves réflexions à
partir des exemples espagnol et italien, par Gilbert Orsoni
• ÉTUDES
Le contrôle de la gestion publique par la Cour des comptes et par le Parlement
: concurrence ou complémentarité?, par Philippe Dautry et Philippe
Lamy
Les fonds spéciaux. Constitution à l’étude des marges
du droit.
Première partie, par David Biroste
Les fonctions de la propriété : propos iconoclastes d’un
fiscaliste sur une
institution du droit civil, par Laurent Gimalac
La réserve parlementaire, par Jean-Luc Albert
• CHRONIQUE DE GESTION PUBLIQUE
Les cibles de résultats sont-elles utiles pour mieux gérer l’État?,
par Bernard Abate
• CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE
Le Conseil constitutionnel, les finances publiques et les finances sociales,
par
Xavier Prétot
• CHRONIQUE BUDGÉTAIRE
L’exécution de la loi de finances pour 2000, par Gilbert Orsoni
• CHRONIQUE HISTORIQUE DE FINANCES PUBLIQUES
Préambule. Naissance d’une rubrique, par Robert Belot
Un mémoire pour l’Histoire? Pierre Cathala, Face aux réalités.
La direction des finances françaises sous l’Occupation,
par Robert Belot
Aux sources de l’idée de « retenue à la source »,
par Jean-Yves
Nizet
Jean Nicolas, La Rébellion française, compte-rendu d’ouvrage,
par Guylaine Bourdais
Un financier engagé : Francesco Saverio Nitti (1868-1953), par Xavier
Naïmi
• TRIBUNE LIBRE
Pour un suivi de l’application de la LOLF, par Didier Migaud
• CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE
I. – Comptes rendus d’ouvrages, par Bernard
Plagnet, François Morvan , Franck Waserman , Irène Bouhadana et
William Gilles.
II- Vient de Paraître