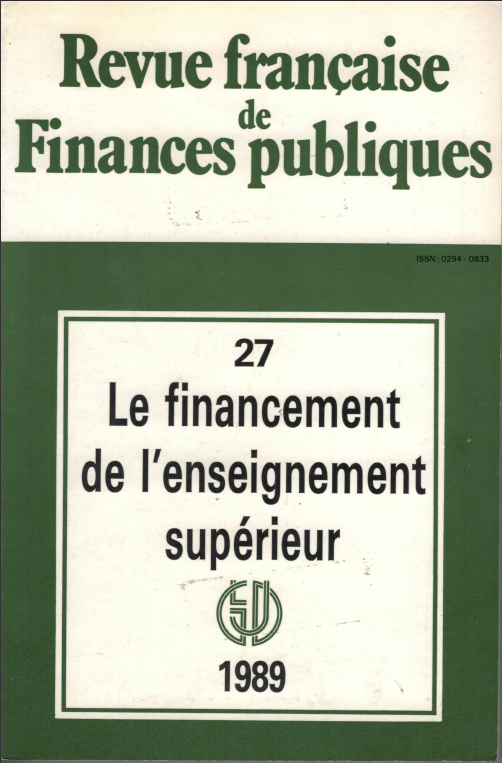ÉDITORIAL
L'enseignement supérieur est-il en mesure d'assumer son avenir ? Ce n'est évidemment pas de la capacité intellectuelle, pédagogique ou de recherche des établissements dont il est question dans ce numéro mais bien plutôt de leurs possibilités financières et de gestion. Une question au demeurant fondamentale si l'on observe l'évolution interne du système d'enseignement supérieur français mais plus encore si l'on se place dans la perspective du proche futur européen.
Ce numéro 27 est en grande partie composé des Actes du colloque des 26 et 27 avril dernier, organisé conjointement par le journal " Le Monde " et la RFFP, avec le soutien de la Caisse des dépôts et consignations et de la Commission des Communautés européennes, sur le thème " Le financement de l'enseignement supérieur ". Nous voulons dire d'abord notre très grande reconnaissance à tous ceux, présidents de séance, rapporteurs, intervenants, qui ont fait le succès et l'extrême richesse de ces deux journées. Nous adressons par ailleurs nos plus vifs remerciements à M. Lionel Jospin, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, qui a bien voulu honorer de sa présence nos travaux et nous associons à ces remerciements M. Hubert Curien, ministre de la Recherche et de la Technologie qui a accepté avec une grande simplicité de participer à la dernière table ronde de la deuxième journée. Qu'il nous soit permis de dire enfin notre extrême gratitude à M. André Fontaine, directeur du journal " Le Monde " et au doyen Georges Vedel qui ont bien voulu tous deux accepter la charge d'ouvrir ces deux journées et nous faire l'honneur et l'amitié de leur présence.
Les travaux publiés ci-après ont, nous semble-t-il, ce mérite particulier que l'on y trouve sous la plume de quelques uns des meilleurs spécialistes français et étrangers, non seulement un constat très minutieux de l'état actuel du financement de l'enseignement supérieur, mais également un ensemble de pistes et de propositions qui ne manqueront pas de retenir l'intérêt.
Les problèmes ne manquent pas. Les investissements dans l'enseignement supérieur, une question cruciale, comme le montre l'article de M. Bourjol, devront connaître, dans les prochaines années, un développement considérable à la fois pour combler le retard et pour faire face à la croissance attendue des effectifs étudiants. Quelle part de son budget l'État pourra-t-il y consacrer ? Sous quelles formes devra-t-on faire appel à d'autres partenaires (collectivités locales, entreprises, banques...) ? Quelle part les usagers pourraient-ils prendre au financement de leur propre formation ? Quelle doit être la stratégie des établissements et faudra-t-il donner à leurs responsables une formation au management ? Car, en l'état actuel des choses, le système d'enseignement supérieur français paraît difficilement pilotable, que ce soit par le haut ou par le bas, et ce tant par manque de moyens financiers que du fait d'une législation parfois inadaptée, sans compter les contraintes administratives qui viennent, parfois, alourdir ces handicaps.
Parmi les pistes de réforme soulevées, - on précisera qu'il ne fut pas question au cours de ces deux journées des problèmes de carrière ou de rémunération des personnels enseignants et chercheurs - un impératif paraît prédominer : la question du financement de l'enseignement supérieur se pose tout autant en termes de structures qu'il conviendrait de créer ou de réformer dans le sens d'une autonomie plus effective que de moyens strictement financiers.
Ainsi, et pour répondre à la double contrainte qui se profile déjà, résultant de la croissance des effectifs étudiants difficilement compatible avec le maintien ou le développement de centres d'excellence, faudra-t-il par exemple, sur la base de l'exemple américain (cf. l'article de J.-P. Lassale) envisager la nécessité de deux types d'établissements qui les uns (ceux de premier cycle) seraient financés par l'État, les régions, les villes, les autres (ceux de 2e et 3e cycles) par un ensemble de ressources diverses venant aussi bien du secteur public que du secteur privé ?
Autre voie souhaitée (cf. R. Rémond et J.-L. Quermonne), faudra-t-il s'engager davantage, relativement à la situation des établissements, dans une logique d'autonomie et de décentralisation proche de celle déjà mise en place pour les collectivités territoriales, seule voie susceptible de générer un esprit d'équipe, le désir d'entreprendre, la capacité d'élaborer des stratégies et ainsi de se poser en acteur à part entière vis-à-vis des autres partenaires, État, collectivités locales, entreprises ? Et, plus largement, faut-il préconiser, comme le doyen Vedel, une voie régionale au lieu et place de la centralisation actuelle, incompatible avec les enjeux d'aujourd'hui.
Sans qu'il soit possible de relever ici toutes les réflexions présentées dans le cadre de ce colloque, le lecteur de ces Actes ne pourra manquer d'être frappé par le caractère extrêmement stimulant de l'ensemble, ce qui, malgré les problèmes et difficultés actuels, peut peut-être laisser augurer d'un avenir moins sombre que celui qui est parfois présenté.
Michel Bouvier
Marie-Christine Esclassan