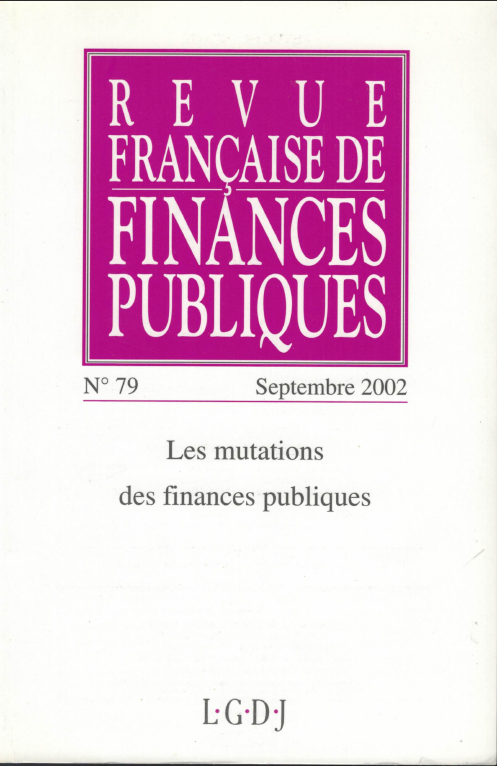
Éditorial : Mutations des finances publiques : du « macro » au « micro »? par Michel Bouvier (3)
• LES MUTATIONS DES FINANCES PUBLIQUES
Avant-propos, par Robert Hertzog (9)
La loi organique du 1" août 2001 et le droit constitutionnel des finances publiques, par Lucille Tallineau (13)
Droit budgétaire et droit parlementaire, par Jean-Pierre Camby (23)
La protection sociale et les nouvelles frontières entre finances publiques et finances privées, par Loïc Philip (33)
L'impact des privatisations sur le budget de l'État en France, par Antoinette Hastings-Marchadier (43)
Budget de la défense et réduction des dépenses publiques, par Matthieu Conan. (87)
L'évolution du contrôle financier des administrations locales, par Bernard Levallois (111)
L'emprise croissante du droit sur les politiques budgétaires, par Sylvie Caudal. (121)
La réforme du Règlement financier communautaire: un exemple de la modernisation du droit budgétaire, par Vincent Dussart (141)
L'État et les marchés : l'émission des titres publics depuis l'Union européenne et monétaire, par Xavier Cabannes (165)
L'euro et les nouvelles marges de manoeuvre de l'État, par Michel Dévoluy (185)
Les lois de stabilité budgétaire du Royaume d'Espagne, par Javier Lasarte Àlvarez et Francisco Adame Martinez (201)
La difficile intégration des règles budgétaires et comptables des États membres de l'Union économique et monétaire Ouest-Africaine, par Salif Yonaba (221)
Mutations des finances publiques et crise du pouvoir politique ?, par Michel Bouvier (241)
La mutation des finances publiques : manifeste pour une discipline rajeunie !, par Robert Hertzog (259)
• ETUDES
Pourquoi il ne faut pas amender le Pacte de Stabilité et de Croissance, par Xavier Denis (281)
Le Comité budgétaire 1940-1944. Préparation, exécution et contrôle du budget sous l'Occupation, par Xavier Naimi (287)
• CHRONIQUE DE COMPTABILITE PUBLIQUE
Jurisprudence 2001, par Alain Chabrol et Corinne Soussia (311)
• CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE
Comptes rendus d'ouvrages, par Irène Bouhadana, William Gilles, Gilbert Orsoni et Xavier Prétot (341)