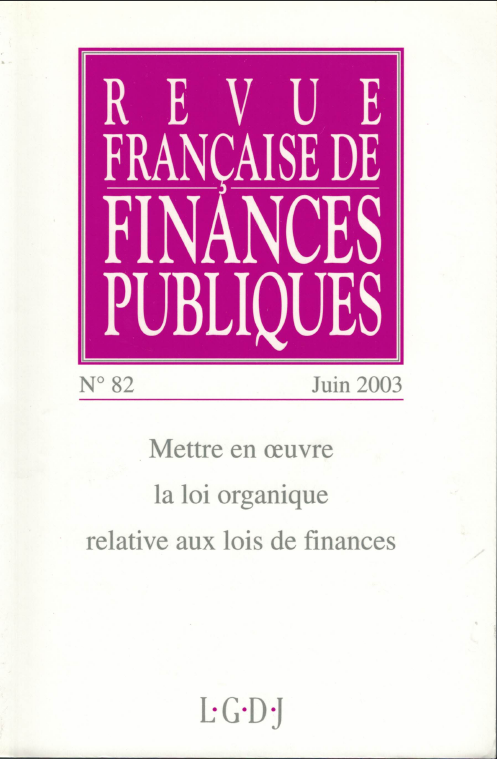
• METTRE EN OEUVRE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES
La loi organique relative aux lois de finances : une chance et un défi, par Yves Cannac
La mise en oeuvre de la LOLF : un chantier de conduite de changements, par
Alain Lambert
Une réforme capitale à mettre en oeuvre, par Jean-Louis Debré
Réflexions à propos de la mise en oeuvre de la loi organique
relative aux lois de finances, par Jean Arthuis
Mise en oeuvre de la LOLF : les évolutions dans les relations entre l'exécutif
et le législatif, par Didier Migaud
La moderfie en marche, par Franck Mordacq
La réforme budgétaire ; un modèle de rechange pour la gestion
de l'État?, par Bernard Abate
La LOLF et la modernisation de la gestion publique, par Pierre Séguin
Après la réforme de la LOLF. Un nouveau partage des responsabilités
?, par Patrick Suet
La nouvelle constitution budgétaire et les méthodes de contrôle,
par Sophie Mahieux
Les nouvelles modalités du contrôle des services, par Jean-Raphaël Alventosa Le contrôle financier et la LOLF du ler août 2001 : vers un désengagement progressif, par Nicolas Clinchamps
La nouvelle loi organique et les gestionnaires. Feu de tourbe ou feu de paille ?, par Claude d'Harcourt
Les indicateurs de performance de la dépense publique, par Raphaël Poli
Le pouvoir d'amendement des parlementaires en matière financière
au regard de la loi organique du ler août 2001 relative aux lois de finances,
parCaroline Laly Chevalier
• ETUDE
La soumission des autorités publiques nationales aux règles communautaires
de concurrence, par Druon Delnt
• TRIBUNE LIBRE
Péréquation : passer la main, tendre la main ou se prendre en
main ?, par Dominique Hoorens
• CHRONIQUE : L'ACTUALITÉ DANS LES CHAMBRES RÉGIONALES DES
COMPTES
Le nouveau régime des délégations de compétence
de la Cour des comptes aux Chambres régionales des comptes, par Christian
Descheemaeker
• CHRONIQUE DE FINANCES SOCIALES
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2003, par Rémi
Pellet
• CHRONIQUE ÉTUDIANTE
Les jeunes étudiants et la décentralisation, par Alice Lachèze
et Sylvie Le La réforme de la décentralisation vue par des élus
locaux, par Elsa Nicolle et Emmanuelle Zuccarelli
CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE
- Comptes rendus d'ouvrages, par Audrey Maruani, François Morvan, Gilbert
Orsoni, Gisela Suchy, Jérôme Sgard et Franck Waserman
I. - Vient de paraître
II. - Colloques et conférences-débats